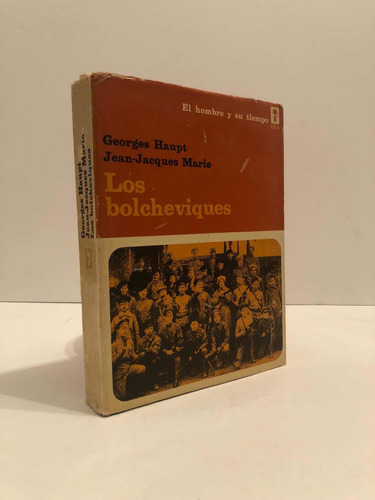A biographical sketch of Lichtenstad is possibile read here.
Héros et martyrs du communisme: Vladimir Ossipovitch, Lichtenstadt – Mazine – Victor Serge
Bullettin communiste 6 octobre 1921
I
Les révolutions sont surtout faites par les élites audacieuses et généreuses. Soutenue par les masses, une minorité d’initiative va de l’avant, prodigue les sacrifices, assume les responsabilités, ouvre les voies nouvelles. Pour vaincre, il faut qu’elle soit nombreuse; il faut qu’elle groupe tout ce qu’il y a de beau et de fort dans une génération montante. Parmi les dizaines de milliers d’hommes — et souvent de héros — qui la composent, quelques-uns, aux heures mémorables de l’histoire, émergent au-dessus de la foule, soit qu’ils aient du génie, soit — bien plus souvent sans doute — qu’une circonstance leur en tienne lieu. Les noms de ceux-là demeurent seuls à jamais gravés dans les fastes de l’humanité. Et ce serait parfois la plus grande injustice, si nous ne savions tous, au fond, que les plus humbles et les plus inconnus sont souvent les meilleurs, les plus grands, les plus beaux…
Pour comprendre la révolution russe, il faudra plus tard étudier les hommes qui l’ont faite, non seulement les Illustres, les “chefs”, dont les statues vont désormais dominer les carrefours de l’histoire, mais les innombrables vaillants qui n’auront pas laissé de noms. On se demandera comment ils ont pensé, voulu, vécu, lutté et comment ils sont morts. Des érudits s’efforceront à reconstituer l’histoire de leurs idées. On déplorera qu’ils ne nous aient presque rien laissé : une poignée de lettres et de souvenirs. Car, seuls, ils pourront faire comprendre la puissante race révolutionnaire qui triomphe et disparaît aujourd’hui en Russie. Etait-elle très nombreuse ? Non, certes, par rapport à l’immense peuple russe qu’elle a entraîné vers l’avenir. Il est possible d’établir des statistiques approximatives du nombre de militants des différentes organisations à la veille de la révolution. Il ne dépasse pas quelques dizaines de milliers d’hommes. Depuis la victoire de la révolution, ce nombre n’a pas augmenté, bien qu’une génération nouvelle, très différente de la précédente et, a certains égards, d’une trempe révolutionnaire bien moindre, ait remplacé tous ceux qui sont tombés. Il y a maintenant plus de 600.000 communistes en Russie ; mais nul des membres éclairés du parti n’ignore que moins du sixième de cet effectif total est composé de communistes réellement convaincus et éprouvés. La grande masse ouvrière vient d’instinct au parti de la révolution et a besoin d’un grand travail d’éducation. Si peu nombreuse qu’elle soit, notre race révolutionnaire a fait de grandes choses : deux révolutions, celle de Mars, politique, contre l’autocratie ; celle de Novembre, sociale, contre le capital ; puis, des années de guerre à l’intérieur contre la réaction sournoise, contre la faim, la ruine, l’ignorance, les hérédités mauvaises — redoutable coalition ! — à l’extérieur, contre les grandes puissances de réaction… Or, elle a vaincu. Car elle peut disparaître après cet effort prodigieux : le vieux monde est ébranlé tout entier par sa victoire morale indiscutablement acquise.
Voici un homme de cette race. J’aurais voulu consacrer à sa mémoire une monographie complète. D’autres la feront peut-être bientôt : l’homme était de valeur et vaut d’être connu. Ne sachant de sa vie et de sa pensée que les grandes lignes, je ne puis que tracer de lui un portrait — ou plutôt l’esquisse d’un portrait. Ce sera quand même utile. Le révolutionnaire était en lui typique. Il avait passé par toutes les rudes écoles de sa génération, parcouru les stades d’une longue évolution psychologique avant de devenir un communiste. Communiste, il l’a été sans réserves, jusqu’au don absolu de soi-même La formation et le caractère de tels hommes sont pleins d’enseignements. Et leur exemple doit rester, — et c’est un devoir chez ceux qui leur survivent de ne laisser perdre ni l’enseignement, ni l’exemple, ni simplement et pieusement, le souvenir.
II
Pour honorer lui-même une semblable mémoire, Vladimir Ossipovitch Lichtenstadt [1] avait adopté, depuis sa sortie de la forteresse de Schlüsselbourg, le pseudonyme de Mazine. Le véritable Mazine, Anton Mazine, il l’avait connu à la forteresse de Schlüsselbourg. C’était un homme de volonté puissante que la prison n’avait pu briser. Vladimir Ossipovitch Lichtenstadt nous a laissé de celui dont il devait porter le nom et répéter le sacrifice volontaire, un portrait en vingt lignes. Et la parenté spirituelle m’apparait saisissante entre ces deux révolutionnaires : le “forgeron corpulent, sanguin, de manières rudes, qui était la volonté même… qui savait apprendre dans toutes les circonstances et tous les milieux, toujours apprendre ; qui, s’il n’était pas grand théoricien, avait l’instinct et le tempérament prolétarien le plus sûr, et qui devait, dès 1918, se faire tuer à Rostov au premier rang des communistes…” — et l’intellectuel, d’esprit souple et délié, venu au prolétariat pour se donner tout entier. Il y a donc derrière la mémoire de Vladimir Ossipovitch Mazine la grande silhouette d’un prédécesseur, de cet Anton Mazine dont on ne sait guère plus que ce que je viens d’en dire : qu’il fut un héros avec simplicité. Figure effacée, discrète, un peu mystérieuse dans la pénombre d’une destinée, mais qui complète un symbole : la continuité du dévouement et de la volonté chez des hommes appartenant à la même race spirituelle.
III
Comme son nom l’indique, Vladimir Ossipovitch Lichtenstadt (Mazine) était juif, fils d’intellectuels. Sa mère lui a survécu. Il semble que régnait autour d’elle, dans sa pauvre demeure dévastée, l’atmosphère intime, de culture, de travail, de probité où l’enfant grandit et se fit une âme forte. Marina Lvovna Lichtenstadt connaît quatre ou cinq langues ; elle a écrit et traduit des essais, des critiques, des ouvrages littéraires. Son logis étroit — deux ou trois pièces exiguës — ne contient en somme qu’un piano, des livres, des portraits : ceux de son fils, naturellement, et des auteurs préférés de son fils, un Nietzsche, un Gœthe. Ce pauvre logis où la vieille femme casse elle-même, péniblement, son bois — quand il y en a — est encore visité de quelques femmes, veuves ou esseulées, qui survivent à toute une pléiade d’intellectuels ; la fille du grand écrivain Gleb Ouspensky, la compagne du socialiste-révolutionnaire Tchernov et quelquefois la femme de Kerenski. Ces intellectuels ne sont plus. Après avoir magnifiquement lutté, ils ont commis d’impardonnables fautes et quelques-uns d’entre eux ont fini par tourner leurs armes contre la révolution. Toujours est-il qu’il y a vingt ou trente ans, le petit milieu très fermé où vivait Marina Lvovna et son fils était bien celui qu’il fallait pour orienter l’esprit, d’un enfant, puis d’un adolescent, vers l’idéalisme révolutionnaire. On ne s’y préoccupait ni de carrières, ni d’affaires, ni d’intrigues. On y pensait à la Constitution, au socialisme, à la révolution. On lisait les poètes et les philosophes. Le garçonnet pensif dut connaître dès sa douzième année les tragiques poèmes de Nekrassov sur la grande misère du peuple russe, et grandit en lisant Dostoïevsky, Tolstoï Tchekhov. Austère école pour un esprit en formation — et que nous voilà loin des romans d’aventures et des journaux sportifs ! Il entrevoyait autour de sa mère des hommes qui sortaient de prison, qui revenaient d’exil, qui se cachaient, qui étaient illégaux, qui disparaissaient soudainement, emmurés dans les geôles du tsar, ou bannis, ou perdus on ne savait comme.
Je ne sais rien de plus de son enfance. L’adolescent fut sérieux et, de bonne heure, travailleur. Ce qu’il y a d’exubérance dans toute sa jeunesse se dépensa chez lui en lyrisme. Il admira les poètes et, probablement, fut quelque peu poète lui-même. Parmi ses premiers travaux personnels furent des essais d’esthétique et une traduction en russe, d’un style remarquablement soigné, des Paradis artificiels, de Baudelaire.
Comment devint-il révolutionnaire ? En Russie cette question fait sourire. Ne pas être révolutionnaire dans ce milieu, à cette époque eût été très surprenant. Toute la jeunesse des écoles était social-démocrate, socialiste-révolutionnaire, anarchiste. Dans les quartiers ouvriers, dans les universités, la révolution fermentait déjà. Ses idées hantaient tous les cerveaux. En dehors d’elles il n’y avait ni vie publique, ni aspirations d’aucune sorte. L’art même était rigoureusement social. Presque tous les poètes russes ont connu l’exil, tous les romanciers ont été des pionniers de la révolution dans les mœurs et dans les cerveaux, des accusateurs de l’ancien régime.
Vers 1904 ou 1905, Vladimir Ossipovitch, alors âgé de 22-23 ans, revenait d’Allemagne en Russie. Il avait complété ses études à l’Université de Leipzig ; son esprit grave et curieux s’était passionné pour les recherches nouvelles d’Avenarius et d’Ernst Mach, — qu’il devait plus tard relire si longuement à la forteresse de Schlüsselbourg. Mais sans doute la prochaine révolution posait-elle déjà devant lui son redoutable point d’interrogation. Comment n’eût-il pas été conquis par toutes les fibres de son être à la révolution qui venait parmi des souffrances sans nom, — et quelles espérances, et quels héroïsmes ! — à la révolution nécessaire ? La jeunesse du moment ne vivait que pour elle. C’était l’époque des luttes épiques de l’organisation de combat socialiste-révolutionnaire. L’étudiant Stépan Balmachov exécutait le ministre de l’Intérieur Sipiaguine. Des attentats contre le vieil homme d’Etat Pobiedonostsev, contre le policier Kleigels, contre le gouverneur de Kharkov, Obolensky, — l’exécution de Bogdanovitch à Oufa, multiplient les gestes audacieux et les sacrifices. Grégor Guerchouni dirigeait, contre les grands dignitaires de l’autocratie, les coups de la vindicte révolutionnaire. En 1904, Egor Sazonov jetait sa bombe sous le carosse de von Plehve.
En 1903, Vladimir Ossipovitch Lichtenstadt, revenu des paisibles cités savantes d’Allemagne où peut-être il avait rêvé de consacrer sa vie pensive aux recherches scientifiques, se trouvait un dimanche de neige dans la rue de Saint-Petersbourg. On était le 22 janvier. Le grand cri des misères montait enfin des faubourgs ouvriers, irrésistiblement ; et, ce jour-là, deux prêtres, deux popes, aimés des humbles vers lesquels ils allaient, devaient conduire la foule grise des travailleurs au tsar, chef de la chrétienté orthodoxe, père de son peuple. Les pauvres gens des usines et des ateliers, les hommes, les femmes, les enfants misérables, s’en allaient par les rues, vers le Palais d’Hiver, conduits par Serge et Gapone qui portaient, comme une icône, le portrait de Nicolas II. Sous les fenêtres du palais la troupe les attendait. “Si le peuple n’est pas séditieux aurait dit le tsar, traitez-le comme s’il l’était !” Et : “N’épargnez personne !” Des feux de salve accueillirent les pétitionnaires. La neige fut horriblement rougie. Dans les rues avoisinant la place du Palais, les cosaques en démence poursuivirent la foule affolée. De telles scènes se produisirent qu’on s’en souvient encore à Petrograd. L’étudiant Lichtenstadt était dans la foule ce jour-là. Il entendit siffler les balles, râler les agonisants. Qu’il était loin désormais des laboratoires et des bibliothèques de Leipzig ! On raconte qu’il erra toute la journée, dans les rues, désespéré, exaspéré, plein d’une terrible colère… Il passa les journées suivantes à polycopier des manifestes commentant les événements. Cette propagande clandestine, dangereuse, où il fallait tout faire soi-même, avec un outillage de fortune allait l’absorber de plus en plus complètement.
Les événements se précipitaient. On était en pleine tourmente. La flotte de la mer Noire se mutinait. Le Kniaz Potemkine arborait le drapeau rouge et, stoïque, le lieutenant Schmidt se laissait fusiller. La terreur se généralisait. Chaque jour les journaux publiaient une liste des attentats. La bombe de Kaliaev déchiquetait à Moscou le grand-duc Serge ; et la pendaison du terroriste ajoutait un nom à ceux des martyrs… La grève générale semblait enfin abattre l’autocratie dont le manifeste du 17 octobre signifiait l’abdication. Aux jours d’angoisse et de fureur succédaient les jours de liberté, le 15 octobre on censurait encore Tolstoï, les poètes, les vaudevillistes, les astronomes et les médecins (il y avait des éditions clandestines de Résurrection contenant des pages interdites), les bouches étaient muettes, les partis illégaux. Le 20 octobre les journaux socialistes et anarchistes de vingt nuances paraissaient partout : clubs, sociétés, partis, naissaient au grand jour dans une joyeuse exaltation. Cela ne devait pas durer longtemps : le temps pour l’autocratie de procéder à un regroupement de forces, de prendre quelques mesures de police, — et la réaction démasquait ses batteries. A la dissolution de la première Douma, répondaient les soulèvements de Cronstadt et de Sveaborg. A Helsingfors les premières gardes rouges se formaient. — Vladimir Ossipovitch Lichfenstadt adhérait alors au groupe socialiste-révolutionnaire maximaliste.
Les maximalistes constituent la gauche — et une gauche extrême — du Parti socialiste-révolutionnaire. Par leur énergie, par leurs procédés — terrorisme agraire ou politique, expropriations, mode d’organisation accordant une très grande autonomie aux groupes — ils se rapprochaient des anarchistes avec lesquels il leur arriva maintes fois de collaborer. Réagissant contre la centralisation du Parti S.-R., contre son idéologie officielle et modérée, ils préconisaient la réalisation immédiate, par la révolution sociale, du programme maximaliste : expropriation des terres et de l’industrie ; ils s’affirmaient radicalement antiparlementaires et comptaient sur la faculté créatrice des masses. Deux hommes, extraordinaires d’énergie et d’audace, de ceux dont la biographie est faite d’aventures épiques, dirigeaient l’action de cette minorité “maximaliste”, où n’entraient que des esprits libres et des tempéraments résolus : Sokolov (“l’Ours” pendu en 1906) et Salomon Ryss (“Mortimer”). Ce dernier, pour mieux préparer ses coups, était entré en contact avec la police ; il réussit à se jouer du directeur de la Sûreté. Agissant avec le consentement de militants éprouvés, il égara sciemment les recherches et assura l’immunité de son. organisation. C’est dans ce milieu que vécut Vladimir Osipovitch Lichtenstadt, entre vingt-trois et vingt-cinq ans. Quel rôle fut exactement le sien ? Je sais seulement qu’il participa aux deux plus fameuses entreprise de l’organisation de combat maximaliste. Le 12 août 1906, trois de ses membres se rendaient pendant une fête à la villa Stolypine — île des Apothicaires — et la faisaient sauter. L’explosion, qui leur coûtait la vie, tuait 62 personnes et en blessait 22 autres. Le 14 octobre suivant, un groupe nombreux de militants dévalisait en plein jour, au centre de Pétersbourg, la voiture d’un fonctionnaire de l’Etat. Poursuivis de rue en rue, les maximalistes se défendirent à coups de revolver. Dix étaient néanmoins arrêtés. De ces dix, sept furent pendus. Vladimir Ossipovitch Lichtenstadt, d’abord condamné à mort, vit sa peine commuée en réclusion perpétuelle (Expropriation du Fonarny péréoulok). Notons ici que ces “expropriations” — pour employer le terme russe — accomplies au nom d’un groupement révolutionnaire, avaient uniquement pour but d’alimenter la caisse des organisations, et que nul militant ne pouvait, sous peine d’exclusion immédiate ou de mort, distraire à son profit personnel quoi que ce soit des sommes prises.
 English
English Pрусский
Pрусский Français
Français Español
Español